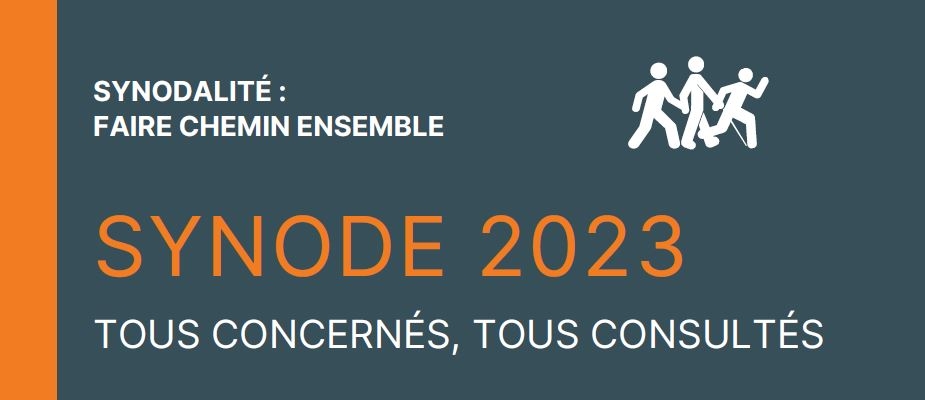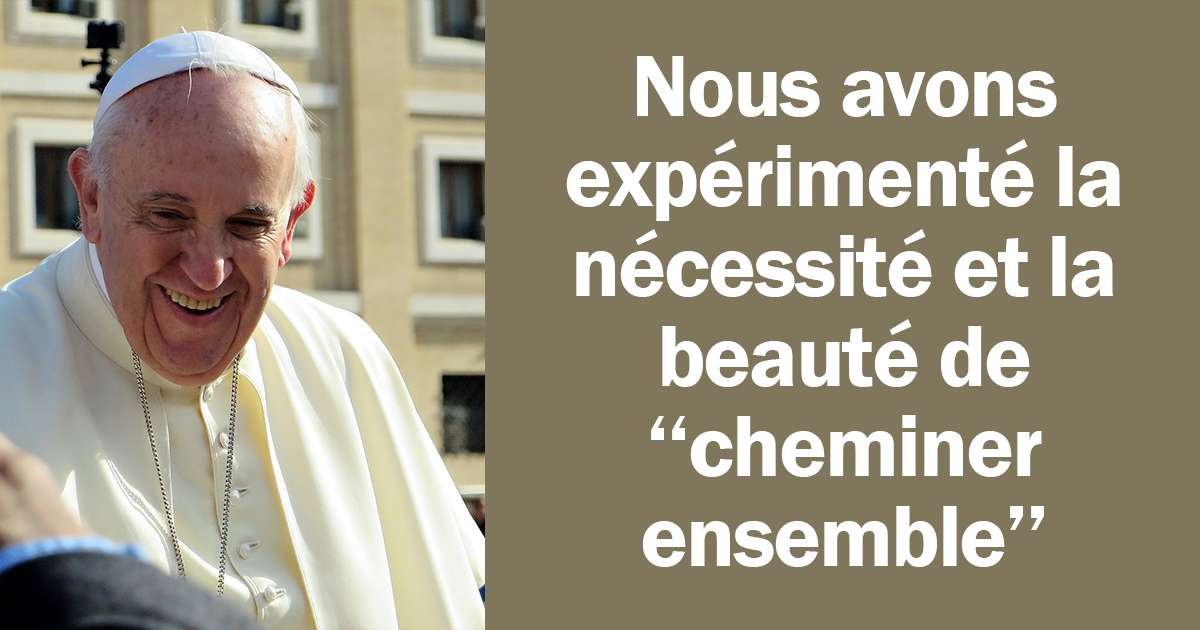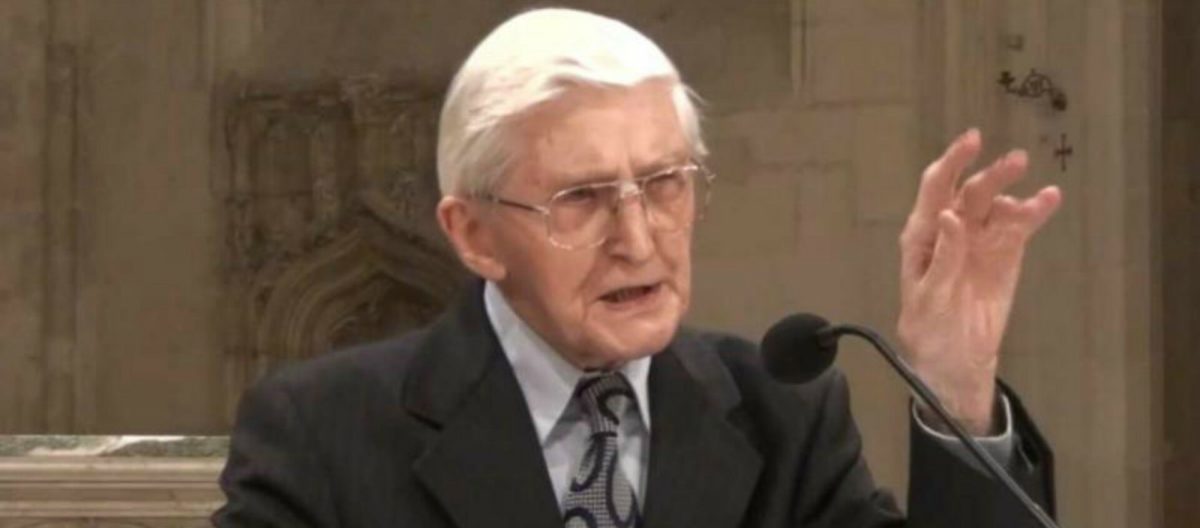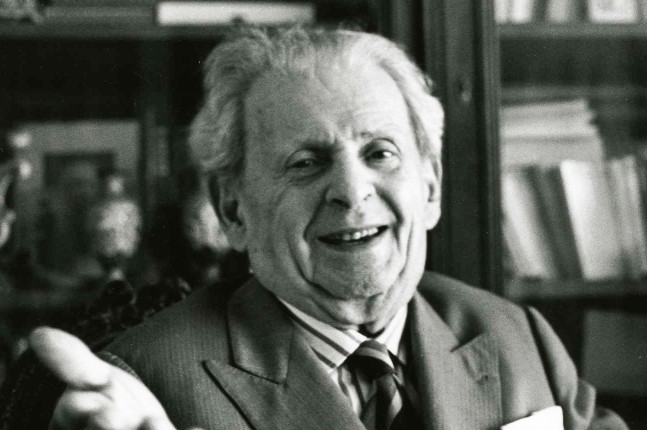Mois : mai 2022

Fête de la Pentecôte – Année C – 5 juin 2022 – Évangile de Jean 14, 15-26
Évangile de Jean 14, 15-26 Esprit, Souffle sur l’Église en Synode Comment imaginer l’état de bouleversement, de sidération dans lequel se trouvent les apôtres après la disparition définitive de Jésus ? Tout s’est passé tellement vite. Ils étaient des hommes du peuple, de la campagne, sans titres ni fortune, exerçant de petits métiers, pêcheurs, douanier …Un…

« Une Pensée Incomplète »
« Il n’y a rien de plus dangereux pour la synodalité que de penser que nous comprenons déjà tout, […] que nous contrôlons déjà tout », prévient le pape François dans un message à la Commission pontificale pour l’Amérique latine rendu public ce 26 mai 2022. Évoquant la spiritualité des peuples du continent, le pontife argentin explique…

Fête de l’Ascension – Année C – 26 mai 2022 – Évangile de Jean 14, 3
Évangile de Jean 14, 3 « Je vous prendrai avec moi » Quand on dit : « Jésus est monté au ciel », on emploie évidemment une métaphore. Jésus n’est pas un cosmonaute qui, si loin qu’il s’enfonce parmi les étoiles, reste enfermé dans notre monde de l’espace-temps. Saint Luc, le seul évangéliste qui l’évoque, le fait d’ailleurs de deux…

7ème dimanche de Pâques – Année C – 29 mai 2022 – Évangile de Jean 17, 20 – 26
Évangile de Jean 17, 20 – 26 Assumés de Pied en Cap En ce temps d’attente qui, à partir de l’Ascension, nous prépare au don de l’Esprit à la Pentecôte, nous écoutons la dernière partie de la grande prière qui clôture le discours d’adieu de Jésus à ses disciples. En relisant le grand ensemble des…

Synode : L’Avenir de l’Église
Premiers échos de France Le processus a commencé. Partout dans le monde, depuis quelques mois, les diocèses et associations ont débattu sur le questionnaire envoyé. Le journal « La Croix » donne un écho des réponses qui viennent de remonter au secrétariat de Paris. Près de 150.000 personnes – soit près de 10 % des catholiques pratiquants –…

Religion et Foi
par Joseph Moingt, jésuite …. « Il est certain que l’histoire ne revient pas en arrière, donc on ne fera pas revivre exactement les communautés chrétiennes de jadis, le contexte social est très différent. Comment est né l’Évangile ? Dans des groupes de gens, de disciples autour de Jésus. Donc on peut penser que l’Église en se revitalisera…

Société jouissive …et insensée
Au centre hospitalier Laborit à Poitiers, une unité pluridisciplinaire accueille en urgence des jeunes de 12 à 18 ans après une tentative de suicide. Alors que la crise sanitaire a révélé ou accentué les angoisses de nombreux adolescents, la petite équipe a de plus en plus de mal à répondre aux besoins. « Quand dans une…

6ème dimanche de Pâques – Année C – 22 mai 2022 – Évangile de Jean 14, 23-29
Évangile de Jean 14, 23-29 Croire nous consol-id-e Le temps pascal – les 5O jours entre Pâques et Pentecôte – est propice à la méditation des chapitres 13 à 17 de l’évangile de Jean. A la veille de son arrestation et de sa mort, à ses disciples qui, comme le peuple, attendaient le triomphe messianique…

Atmosphère de fin de règne au Vatican ?
Le pape malade a dû se résoudre à se déplacer en chaise roulante mais dit pourtant qu’il va bien et veut toujours réformer l’Église. — Atmosphère délétère de « fin de règne » au Vatican où certains cardinaux préparent l’avenir ou plutôt… le prochain conclave estime Le Figaro dans un long article. Mais le pape rappelle qu’il…

5ème dimanche de Pâques – Année C – 15 mai 2022 – Évangile de Jean 13, 31 – 35
Évangile de Jean 13, 31 – 35 Aimez-vous les uns les autres En entendant aujourd’hui l’ordre de Jésus à ses disciples dans l’évangile de Jean : « Aimez-vous les uns les autres », nous méditons sur la portée de ce « devoir d’aimer » tel qu’il a été peu à peu compris par la tradition. Première Alliance Avant d’être une…

Emmanuel Lévinas – La priorité de l’amour d’autrui : La Sainteté
Extrait de l’entretien avec B. Révillon : « De utilité des insomnies »dans le livre d’E. Lévinas : « Les imprévus de l’histoire » (éd. poche) Imaginons qu’un jeune élève vienne vous demander une définition de la philosophie. Je lui dirais que la philosophe permet à l’homme de s’interroger sur ce qu’il dit et sur ce qu’on se dit en pensant. Ne…

4ème dimanche de Pâques – Année C – 8 mai 2022 – Évangile de Jean 10, 27 – 30
Évangile de Jean 10, 27 – 30 Le Père et Moi, nous sommes UN Y a-t-il une seule page de l’histoire qui ne soit ensanglantée par les guerres? Sans cesse et partout, des individus sont persuadés d’apporter le bonheur à leur peuple, d’écraser les menaces des ennemis, de sauver l’honneur de leur nation. Dans cet…