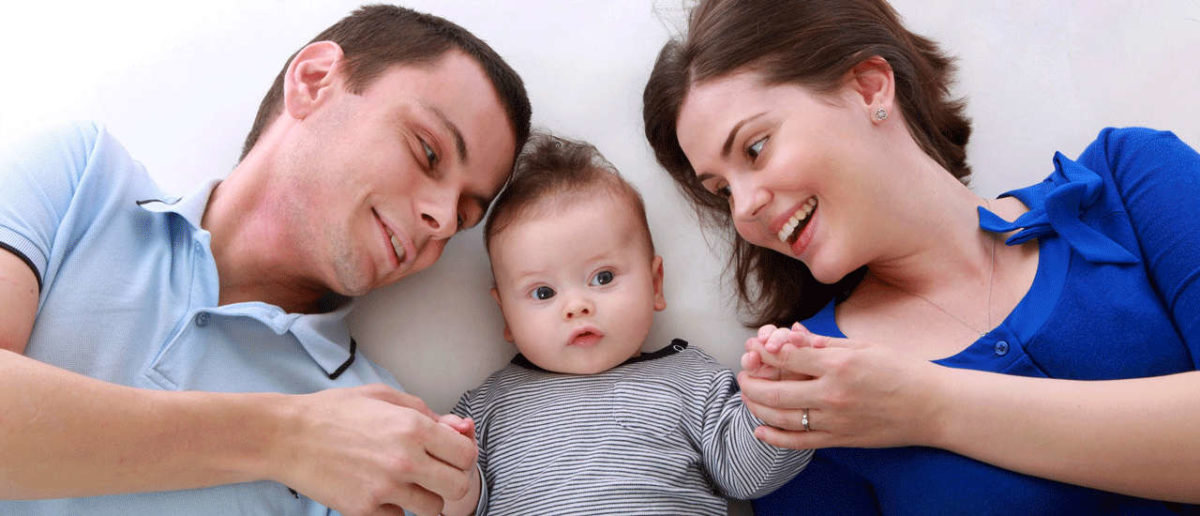Mois : septembre 2021

27ème dimanche – Année B – 3 octobre 2021 – Évangile de Marc 10, 2-16
Évangile de Marc 10, 2-16 Le Mariage et les Enfants Inflexible, Jésus accomplit sa décision d’aller à Jérusalem. De Capharnaüm, il contourne le lac et prend la route qui longe le Jourdain, qui est la frontière orientale d’Israël et descend vers la mer Morte. Il traverse même un gué et fait une incursion en Transjordanie…

La Joie de l’Amour
Exhortation apostolique du Pape François – Extraits 292. Le mariage chrétien, reflet de l’union entre le Christ et son Église, se réalise pleinement dans l’union entre un homme et une femme, qui se donnent l’un à l’autre dans un amour exclusif et dans une fidélité libre, s’appartiennent jusqu’à la mort et s’ouvrent à la transmission de…

26ème dimanche – Année B – 26 septembre 2021 – Évangile de Marc 9, 38-48
Évangile de Marc 9, 38-48 Pas du Sucre : du Sel Tout au long de sa montée à Jérusalem, Jésus travaille à donner un enseignement nouveau à ses apôtres qui le suivent sans comprendre. Il est capital en effet de donner une formation à ceux qui seront responsables de constituer les futures communautés. A la première…

L’Église n’est pas une forteresse, un château
Pape François Cathédrale de Bratislava – 13 09 2021 – 1ère partie C’est bien à toutes les Églises d’Europe que le Pape lance cet important appel à la recherche du changement, à la lutte contre la sclérose, à l’audace. … L’Église n’est pas une forteresse, elle n’est pas une puissance, un château situé en hauteur…

25ème dimanche – Année B – 19 septembre 2021 – Évangile de Marc 9, 20-37
Évangile de Marc 9, 20-37 Le premier sera le dernier et le serviteur de tous La réunion de Jésus avec ses apôtres près de la nouvelle cité hellénistique de Césarée a marqué, après son baptême, le second grand tournant de sa vie. Enfin, après bien des recherches, Pierre, au nom des Douze, proclame qu’ils sont…

Gaël Giraud : 2ème partie
Né en 1970. Ecole Normale sup’ – Math. et Economie –Service civil au Tchad : fonde un centre d’accueil pour enfants pauvres – C.N.R.S. – 2004 : entre chez les jésuites – Publie « Illusion financière » – 2020 : professeur à l’Univ. de Washington – publie « L’Economie à venir ». – Extraits d’une interview dans « La Croix – L’Hebdo » 27.8.21…

Vivre un Monde en Commun
Gaël Giraud, jésuite Né en 1970. Ecole Normale sup’ – Math. et Economie – Service civil au Tchad : fonde un centre d’accueil pour enfants pauvres – C.N.R.S. – 2004 : entre chez les jésuites – Publie « Illusion financière » – 2020 : professeur à l’Univ.de Washington.- publie « L’Economie à venir ». – Extraits d’une interview dans « La Croix –…

24ème dimanche – Année B – 12 septembre 2021 – Évangile de Marc 8, 25-35
Évangile de Marc 8, 25-35 Perdre sa Vie pour la Sauver Le surprenant et très long voyage de Jésus, du lac de Galilée à la côte libanaise puis traversée d’Israël jusqu’à la Transjordanie et retour, est sans doute très significatif. Il lui a permis de découvrir de l’intérieur le monde païen effervescent, les villes bruyantes,…