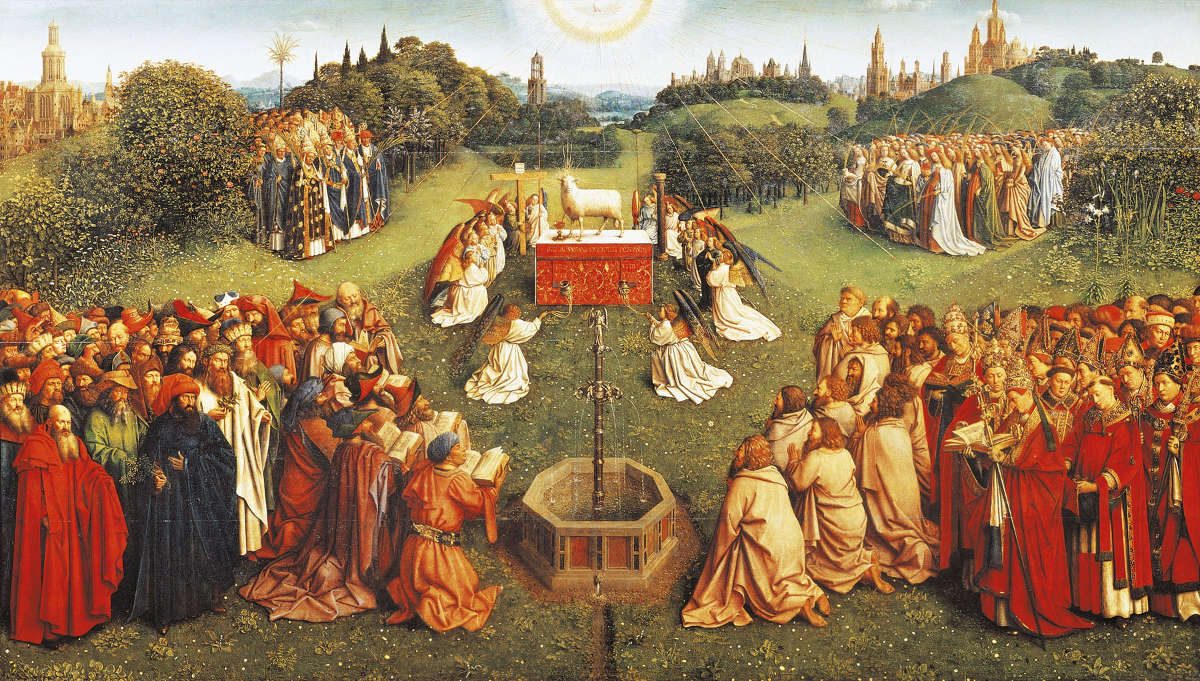Mois : avril 2020

4ème Dimanche de Pâques – Année A – 3 mai 2020 – Évangile de Jean 10, 1-10
Évangile de Jean 10, 1-10 Le Pasteur est bon : les brebis vivent libres Cette célèbre parabole sur Jésus le Bon Pasteur forme la conclusion du chapitre 9 qui a raconté l’histoire de l’aveugle-né. Guéri par Jésus, l’homme a comparu devant le tribunal pharisien qui l’a exclu parce qu’il croyait en Jésus. Le chapitre se terminait…

Les églises fermées, un signe de Dieu ?
Le Père Tomas Halik , ordonné prêtre clandestinement durant le régime communiste, professeur de sociologie à l’université de Prague, lauréat du Prix Tempelton, docteur honoris causa de l’université d’Oxford, nous livre une analyse décapante sur la fermeture des églises face au coronavirus. Son texte suscite déjà un débat en Europe et aux Etats-Unis.

3ème Dimanche de Pâques – Année A – 26 avril 2020 – Évangile de Luc 24, 13-35
Évangile de Luc 24, 13-35 La Fraction du Pain d’Emmaüs En nous empêchant de nous assembler dans nos églises pour vivre les grandes cérémonies pascales, ce temps de confinement a suscité sur les médias une floraison de retransmissions de messes, de moments de prière et de méditation. Ces émissions, très utiles aux personnes qui ne…

L’autre pandémie
Ma femme est infirmière. Elle travaille dans l’un des grands CHU de Wallonie. Durant des années, elle est rentrée le soir complètement exténuée, au terme de journées marathon qui succédaient les unes aux autres. Très régulièrement, au cours de son service, elle n’avait eu le temps ni de s’asseoir, ni de manger, ni même d’aller…

2ème Dimanche de Pâques – Année A – 19 avril 2020 – Évangile de Jean 20, 19-31
Évangile de Jean 20, 19-31 Pâques, c’est Dimanche Lorsque vers la fin de ce qui sera notre premier siècle, Jean rédige son évangile, la foi continue à se répandre mais partout elle se heurte à l’incrédulité : « Jésus ressuscité ? Je n’y croirai que si je le vois ! ». N’est-ce pas au fond une objection humaine normale ? Jean…

La belle histoire d’Arthur Ashe
Quand Arthur Ashe, le légendaire joueur de tennis américain, était en train de mourir du sida qui s’était propagé par le sang infecté administré lors d’une chirurgie cardiaque en 1983, il a reçu des lettres de ses fans, dont l’un a demandé : ” Pourquoi Dieu a-t-il dû vous choisir pour une maladie si horrible ? “…

Dimanche de Pâques – Année A – 12 avril 2020 – Évangile de Matthieu 28, 1-10
Évangile de Matthieu 28, 1-10 Ressuscité oui ou non ? Les enquêtes révèlent que, même parmi les catholiques pratiquants, un nombre non négligeable avoue ne pas croire à la résurrection de Jésus. Or là est le cœur de la foi chrétienne telle que les Apôtres la transmettaient. « Je vous rappelle l’Evangile …par lequel vous serez sauvés (si…

A l’heure de la pandémie, les chrétiens, témoins de l’espérance
Anticipant la fête de Pâques, les chrétiens sont appelés à être les témoins de la Résurrection devant leurs frères dans l’épreuve. Par l’espérance, ils attestent que la mort n’aura pas le dernier mot. Les gestes de dévouement et de solidarité qui se manifestent partout en constituent déjà les premiers signes. La crise sanitaire du coronavirus…