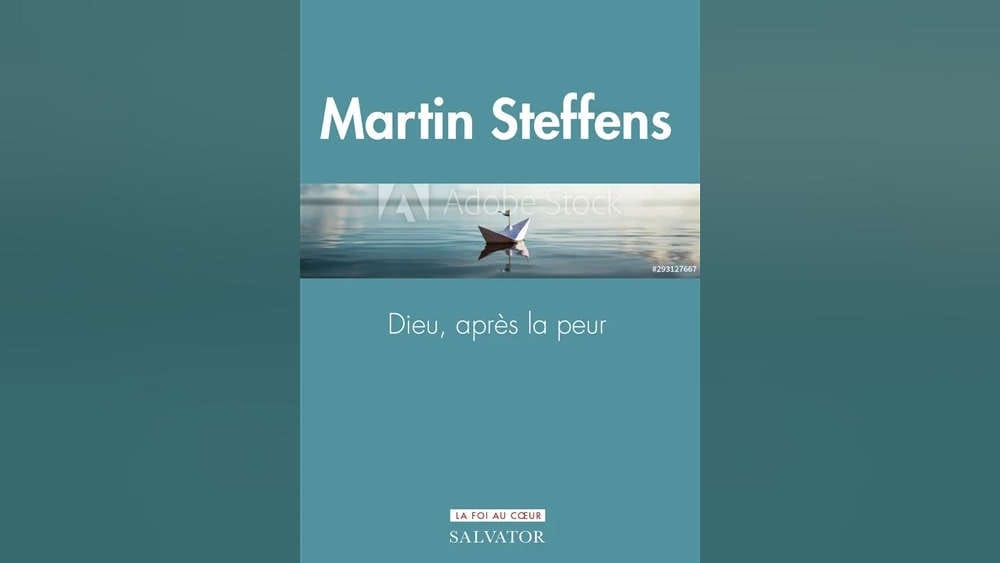Philosophe et enseignant, catholique enthousiaste, auteur de nombreux ouvrages et chroniques, Martin Steffens travaille aussi bien sur les questions de consentement, de paternité que de quête du bonheur.
Dans votre nouveau livre, Dieu, après la peur (1), vous présentez la crainte comme une chance. Cela ne va pas de soi !
Martin Steffens : Justement, la crainte, c’est la rencontre d’un plus grand que soi qui nous bouleverse et nous dérange. Ce qui la distingue des autres peurs, telles que la terreur, la phobie, l’angoisse, c’est que la crainte est relationnelle. En proposant la crainte comme un remède contre nos peurs, cela permet de déterminer de quoi on souhaite avoir peur dans sa vie. De mourir en général, ou de mourir sans avoir aimé ? Ce n’est pas la même chose. La crainte est une ressource positive… qu’on peut chercher à détourner : pour Machiavel, le but du Prince, c’est d’être aimé mais d’abord craint. Dans l’horizon du christianisme, la crainte face à ce plus grand que nous a sa réponse : « Ne crains pas. » Blaise Pascal l’a très bien résumé lorsqu’il dit : « Ne craignez pas pourvu que vous craigniez, mais craignez si vous ne craignez pas. » Dès lors que je suis dans cette disposition à recevoir à tout moment un Dieu qui me dérange et me déplace dans ma vie, je vais m’entendre dire cette parole : « N’aie pas peur. » Par contre, si je reste indifférent, si je pense que la vie ne peut plus me surprendre, il est peut-être temps d’acquérir ce don de crainte.
Le niveau de crainte est-il plus important aujourd’hui qu’hier ?
M. S. : Nous sommes entrés dans un monde où la pulsion de conservation prime le goût du risque. L’aventure chrétienne a un principe : « Que ton règne advienne. » Le règne de Dieu, c’est l’accroissement du cœur au contact de l’Autre. « Qui veut conserver sa vie la perd » est la phrase que le Christ prononce le plus de fois dans les Évangiles. Dans les pays riches, la crise du Covid a commencé par le refus d’honorer les dernières volontés des défunts et elle s’achève par une dénatalité galopante. Cette peur qui entrave la vie, il faut s’en guérir.
Mais comment accepter cette crainte sans céder à l’angoisse ?
M. S. : La pression sur les jeunes que j’ai en cours de philo est énorme, avec la mise en tension, dès la fin du collège, à vite se connaître et trouver sa place quand, dans le même temps, on confie leur avenir à l’algorithme de Parcoursup… Mais si l’on vit avec cette peur de ne pas avoir sa place, on conjugue le monde à partir de l’individu isolé, en lutte avec les autres. C’est l’état de nature ! Mes élèves qui préparent l’École normale supérieure, je les invite à voir que le but initial du concours est d’abord un moyen de vivre de nouveaux apprentissages et rencontres. Celles-ci resteront, même en cas d’échec.
On remarque justement beaucoup de problèmes psychologiques chez les jeunes. Comment l’analysez-vous ?
M. S. : Le confinement leur a fait mal. Peu ont souligné la violence qu’ils ont subie pendant deux années décisives de leur croissance : stages annulés, pas de cours à l’université et, pour les plus petits, des mains passées au gel hydroalcoolique toutes les heures, avec ce masque fiché en permanence sur leur visage… L’école revue et corrigée par l’angoisse des adultes. Comment, dans ces conditions, se sentir accueillis dans le monde ? Aujourd’hui, après avoir culpabilisé de leur propre naissance, parce qu’elle participerait à la catastrophe climatique, on pointe ces jeunes du doigt parce qu’ils s’engagent à corps perdu pour arrêter la machine… Veut-on les rendre fous ? L’urgence est d’écouter leur désir de « bifurquer » tout en leur montrant pourquoi ne pas céder à l’impatience. Car, comme le rappelait Simone Weil, on ne bascule pas dans un autre monde sans avoir patiemment observé quels sont les leviers à notre portée.
Et vous, quelle a été votre enfance ?
M. S. : J’ai eu la chance de grandir dans une famille essentiellement féminine, entre deux grandes sœurs et deux petites sœurs. Je viens d’une classe sociale moyenne, avec un père dans le bâtiment qui a fini par faire carrière à Paris et une mère assistante sociale.
L’une de mes sœurs est devenue infirmière, une autre tient une MJC, une troisième est actrice et, depuis peu, réalisatrice. L’aînée est psychologue. Elle travaille quasi à perte, pour les plus abîmés. Nous avons été marqués par le catholicisme social de mes parents. Nous habitions à Metz dans une rue très pentue, tout en haut d’un immeuble. C’était une maison ouverte à tous, un repaire pour nos amis d’enfance. Un lieu d’accueil malgré notre lot d’épreuves.
La foi avait-elle déjà une place dans votre vie ?
M. S. : C’était un milieu chrétien. À 8 ans, je ne croyais pas en Dieu mais je me disais quand même qu’il fallait que je devienne prêtre, pour qu’il ne m’en veuille pas trop s’il existait ! (Rires.) Je me disais : « Dieu, c’est trop beau pour être vrai. » Mes parents étaient pratiquants mais abîmés, parce que la relation entre eux s’est effritée jusqu’au divorce, tout le monde a abandonné un peu la foi, avant d’y revenir plus tard.
Enfant, vous vous sentiez écouté ?
M. S. : Oui. Nous avions chez nous une table ronde, réalisée par un ébéniste aujourd’hui reconnu qui, à l’époque, nous l’avait cédée. Une pièce de valeur autour de laquelle nous déjeunions, parlions… Il y avait bien sûr des tensions, des moments difficiles. Mais à un moment, un fou rire éclatait. Et rien n’apparaissait plus insurmontable. Ce sens d’un tragique joyeux, un peu comme chez les peuples méridionaux, m’a marqué et m’aide dans mon travail de père et de philosophe. Par son accueil de l’adversité, ma mère m’a appris que le pire qui puisse nous arriver, c’est seulement de ne pas vivre ce que l’on a à vivre, joie ou souffrance. Que peut-on demander de plus ? Être épargné de notre propre vie ? Non.
C’est très stoïcien !
M. S. : En mode franciscain ! Mais oui, chez les stoïciens, si nous ne pouvons pas changer ce qui nous arrive, nous pouvons en revanche agir sur la manière dont nous le recevons. Ce fou rire qui nous dédouanait de tout nous faisait, enfants, réfléchir sur la liberté que nous avions par rapport au « donné ». « Donné », cela veut bien dire qu’il y a d’une part le projet, et de l’autre le projectile, la force qui projette vers l’avant, qui est peut-être plus intéressante que notre projet de départ. Les projectiles, les inattendus, dans une famille nombreuse, ce n’est pas ce qui manque ! Je le vois encore aujourd’hui, avec nos quatre enfants…
Pourquoi avez-vous choisi la philosophie ?
M. S. : Je ne savais pas quoi faire après le bac. J’étais batteur dans un groupe de rock, comme aujourd’hui d’ailleurs, mais avec la ferme volonté de se faire une place dans le paysage musical. À l’époque, avec les deux autres membres, ce groupe était notre projet de vie. Nous répétions quatre fois par semaine. De vrais moines-soldats : on sortait peu, sinon pour donner nos propres concerts. Je continuais mes études uniquement pour ne pas causer du souci à ma mère qui avait, seule, charge d’âmes. J’avais fait une classe prépa en lettres, un peu en touriste. Cela ne me nourrissait plus parce que la mode était au structuralisme. Jamais le texte littéraire ne perçait vers le réel, il était pris dans une sorte de renvoi perpétuel à d’autres textes. J’étouffais. J’en ai parlé à une voisine professeure de philo : « Je veux une parole qui perce vers la vie », résumais-je. Juive athée, elle ne m’a pas dit « deviens prêtre » mais « fais de la philo ! » (Rires.) Et donc je suis parti en philo, par défaut.
Dans ce contexte, comment la foi est-elle revenue dans votre vie ?
M. S. : En 2003, je me suis isolé de tout pour préparer l’agrégation. Je connaissais alors des moments de joie pure. Avec une certitude : je ne sais rien, si ce n’est que la vie est un don. Et je ne pouvais pas m’empêcher de dire merci… mais à qui ? Et j’avais peur : si c’est quelqu’un qui m’appelle, j’allais devoir répondre. J’ai alors cherché dans le bouddhisme. Dans l’islam… mais il n’y avait pas de Dieu donateur. Je suis tombé sur un texte d’Ignace de Loyola qui parle de Dieu comme Donateur, avec un D majuscule. Un Dieu présent sur la croix qui nous dit que tout est payé : « Je remets votre dette, vivez de ce don qui vous dépasse, car le seul moyen de me rembourser, c’est d’être à votre tour des donateurs. » Là, je me suis dit : je suis fichu… J’étais en train de devenir catholique ! (Rires.) Souvent, les choix que nous faisons ne sont pas déterminés par ce qu’on a positivement envie d’être, mais simplement par ce que nous n’avons pas envie de faire.
Mais à côté de nos désirs, il y a aussi ce qui nous constitue. Dans votre livre Tu seras un homme (2), vous vous êtes penché sur le thème délicat de la virilité. Pourquoi cette question revient-elle aujourd’hui dans le débat public ?
M. S. : Les hommes sont en mauvaise santé. Ceux de la génération de mon père ont eu du mal à prendre leur place. C’est d’autant plus dur d’être un homme aujourd’hui que beaucoup de jeunes femmes, je le vois parmi mes étudiantes, disent qu’elles se réjouissent de l’émergence d’un monde où elles n’auront bientôt plus besoin des hommes pour procréer, parce qu’il faut se libérer de l’oppression masculine. Ayant été le seul garçon dans ma famille, ma mère a toujours regardé celui que j’étais avec tendresse. Elle m’a inscrit dans ma masculinité en la bénissant. « Tu seras un homme », ce n’est pas une injonction viriliste, c’est une promesse, confiante, que quelqu’un fait à notre place afin que cette place, justement, nous l’occupions dans la sérénité et la joie.
Cela relève d’une sorte de confusion des sexes ?
M. S. : Naître homme, ou naître femme, c’est d’emblée être privé de toute une partie de l’expérience humaine. Homme, je n’ai pas d’utérus, cet organe qui permet d’accueillir et de donner la vie. C’est donc une tout autre histoire que je suis invité à écrire avec mon corps. Nier cette différence entre l’homme et la femme me paraît inutilement coûteux, et douloureux. Mieux vaut l’élucider, peu à peu, comme un don. Il y a évidemment des êtres pour qui l’acquiescement à leur corps est difficile. Il n’en reste pas moins que l’accueil de sa propre vie est l’horizon à atteindre. Cela permet de convertir le donné de départ, ce corps imposé par ma naissance, en un don que l’on peut non seulement recevoir, mais magnifier. La grande aventure n’est pas d’avoir les moyens de se formater mais plutôt de trouver les ressources pour s’accepter.
Se mettre en couple favorise-t-il ce meilleur rapport au temps et à soi ?
M. S. : Plus j’avance, moins j’idéalise la relation conjugale. L’alliance conjugale nous permet d’expérimenter avec une personne ce que Dieu vit avec chacun et chacune de nous : l’amour dans la miséricorde. Je connais tes failles, tes abîmes, je connais ton péché et toi, tu connais les miens.
Un couple est fondé sur le pardon : on se marie pour apprendre ce que c’est que d’aimer jusque-là. Pardonner, et se laisser pardonner. Savoir que l’autre sait notre fragilité et ne nous en tient pas rigueur. J’irais jusqu’à dire qu’un couple, c’est deux personnes qui apprennent, ensemble, à survivre à leur déception. J’aurais tellement voulu être l’homme qui toujours rassure… et je suis tant et tant d’autres choses !
L’arrivée d’un enfant et l’expérience de la paternité modifient-elles encore l’essence de cette fragilité ?
M. S. : La première chose que j’ai ressentie quand j’ai appris que j’allais être père, c’est que j’étais mortel : venait quelqu’un qui allait me survivre. Cet enfant, je veux mourir avant lui. En même temps, je dois désormais me garder des conduites à risque ! À la fois j’accède à ma mortalité, à la fois elle m’oblige à une certaine prudence.
Au-delà du genre et des modèles familiaux, on observe sur les réseaux sociaux que chacun semble incité, pour s’assurer de son identité, à n’exister qu’à partir de lui-même, sans rien devoir à personne avant lui. Que vous inspire ce narcissisme moderne ?
M. S. : Mais c’est justement cela, la condition humaine : nous, nous arrivons toujours après ! Un de mes livres, le Petit traité de la joie (3), commence ainsi : un homme se réveille de sa sieste et entend l’horloge qui sonne, tente de tenir le décompte des ding-dong, mais sans être sûr d’avoir entendu le premier coup… On se réveille tous au milieu de notre vie. Il y a un décalage incompressible entre la vie reçue et ce que nous déciderons consciemment d’en faire.
La vie arrive avant. Que faire de cette passivité première ? Je vois l’action de grâces ou le pardon moins comme des actes que nous posons de temps en temps que comme des dispositions d’accueil liées à notre condition de retardataire. Car « en retard » ne signifie pas « trop tard ». René Char écrivait : « Tu ne peux pas te relire mais tu peux signer. » On ne peut pas revenir en arrière, mais nous pouvons signer, inscrire nos pas dans ce chemin que la vie a tracé avant nous. Pardonner à son passé ou consentir joyeusement à la vie présente, c’est un seul et même geste.
Un discours très en vogue nous incite inlassablement à effacer ce passé pour vivre « l’instant présent », renforçant cette conception d’un « vrai soi » sans aucune attache. Est-ce une illusion ?
M. S. : Avec cette insistance sur l’instant, qui serait le moment où on coïncide pleinement à soi… En fait, prendre conscience de l’instant, « prendre du recul » comme on dit, nous fait déjà sortir de l’instant ! Quand Jésus dit : « À chaque jour suffit sa peine », il indique que la dimension de notre action ne peut avoir pour mesure ni la vie tout entière, comme dans l’impératif de « réussir sa vie », ni l’instant présent. La durée de notre habitation du monde, c’est le jour : qu’aujourd’hui je sois accueillant de ce que tu me donneras et que, au soir, je puisse espérer avoir fait ce qui convient.
Nous ne pouvons donc pas avoir conscience de ce que nous vivons dans l’instant présent ?
M. S. : J’aime bien le concept de « différance » développé par le philosophe Jacques Derrida : nous différons, nous existons en différé. La preuve : nous avons besoin de raconter notre journée à quelqu’un pour avoir l’impression de l’avoir pleinement vécue. Derrida se méfiait ainsi des penseurs de l’oralité, ceux qui, comme Rousseau ou Lévi-Strauss, fantasmaient un rapport d’autant plus authentique au monde qu’on se passerait de la médiation des mots… C’est au contraire par le détour, par le truchement des autres et des mots, que nous avons accès à soi, jamais dans l’immédiat.
Mais certains événements n’échappent-ils pas à notre récit intime ?
M. S. : Si, bien sûr. Des expériences si fortes qu’elles nous submergent et nous laissent sans voix. Je pense à 14-18 : c’était tellement inouï que les soldats ne pouvaient pas raconter les tranchées. Ils étaient comme collés au présent de leur épreuve, n’avaient pas accès à ce différé pour en parler, en faire une légende, un exploit ou une plainte. C’était impartageable.
Walter Benjamin a un petit texte là-dessus, intitulé Expérience et pauvreté. Selon lui, la crise de l’Europe commence par cet intransmissible. Non pas parce que les hommes qui en reviennent n’ont rien vécu, mais justement parce qu’ils ont trop vécu. À partir d’un seuil de saturation, le vécu devient indicible.
À vous écouter, nous ne sommes donc pas complètement maîtres de notre identité. Que faut-il finalement accepter pour éviter que cette question ne nous tyrannise et nous oppose ?
M. S. : Changer de regard sur le propre de notre humanité. Il y a un contresens majeur sur l’homme que révèlent par exemple des innovations technologiques comme ChatGPT et l’intelligence artificielle : on a cru que l’homme avait des facultés combinatoires, calculatoires, supérieures aux autres animaux. « L’animal rationnel »… Ce qui est proprement humain, ce n’est pas d’enchaîner les signaux adéquats, façon insecte, mais au contraire de balbutier, de se tromper, de pardonner. Je crois au contraire que l’homme est homme par un rapport inefficace, maladroit et gratuit au monde. La contemplation ou l’écoute sont des rapports pauvres au monde : c’est se tenir là, sans rien s’approprier. Il y a une sorte de contresens anthropologique radical de n’avoir pas vu que nous étions originellement pauvres, et par là riches de la relation. L’humain est dans la chair de la relation.
Propos recueilli par Stéphane Bataillon et Christophe Henning,
pour le journal La Croix.
(1) On peut craindre Dieu sans en avoir peur, explique Martin Steffens. L’auteur part en quête de cette « salutaire crainte », « don du Saint-Esprit », dans cet essai paru en avril dernier. Éditions Salvator, 172 p., 16,90 €
(2) Ce n’est pas en détestant les hommes que nous respecterons les femmes : voici la thèse soutenue par Martin Steffens dans cet essai publié à l’heure où le patriarcat est remis en question. Éditions du Cerf, 2021, 200 p., 18 €
(3) Doit-on consentir à une vie qui nous a été donnée sans qu’on la demande ? L’auteur propose de répondre à cette question du consentement à la vie avec un grand oui, « ample comme nos peines, plein comme nos joies ». Éd. Salvator, 2011, 18 €